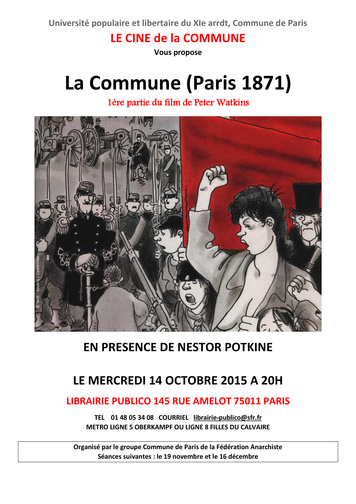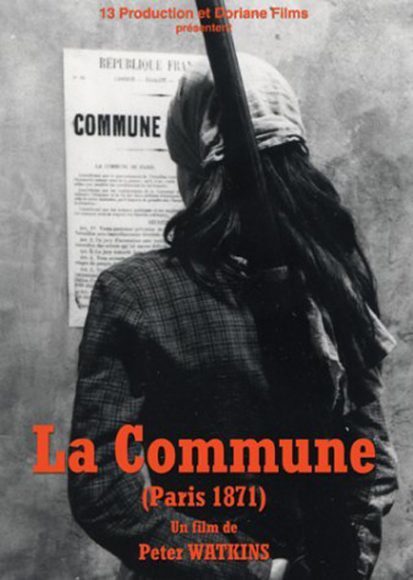http://www.contretemps.eu/r%C3%A9cits/barricadesBarricades
Le 18 mars 1871, le peuple parisien se soulève, en opposition à la tentative d'Adolphe Thiers - fondé de pouvoir des classes dominantes - de s'emparer des armes de la Garde nationale. Dans la foulée, des barricades sont érigées au faubourg Saint-Antoine et à Ménilmontant, signant le début de la révolution sociale et politique connue sous le nom de Commune de Paris. A l'occasion de ce 18 mars, Contretemps vous propose de lire un texte de l'écrivain Pierre Vinclair, intitulé "Barricades", ayant précisément pour cadre cette formidable insurrection populaire qui constitua, selon le mot de Marx, "le glorieux fourrier d'une société nouvelle".
– Extrait de Commune mémoire J'avais compris : je n'en sortirais pas, de Paris.
On pourrissait sur les barricades. Les troufions buvaient toute la journée, jouaient aux cartes en ragotant sur le capitaine et déployaient des bouillies d’opinions immédiatement dissoutes par le soleil qui nous brûlait la face. Ils commentaient la valse des généraux qui prenaient, les uns après les autres, la direction de la Garde Nationale pendant que Versailles les écrasait, jour après jour, sur le front de l’ouest ; et alors que nous n'avions que la rumeur de ces combats, chacun croyait savoir mieux que les autres comment la guerre devait être menée. Les échos d’affaires politiques, les décrets du Conseil, le nombre de prisonniers, de morts et de mouchards exécutés, les messages de Thiers : oui tout ce qui déchaînait leur enthousiasme me glissait dessus.
— C’est évidemment Rossel, qu’il nous faut !
— C’est Dombrowski !
— C’est Delescluze !
— Delescluze est trop vieux ! Pourquoi pas Pyat pendant que tu y es !
— Tous ces vieux briscards qui ne veulent que prendre leur revanche sur quarante-huit ! C’est notre révolution ! Nous en sommes les soldats ! Elle ne doit pas leur servir à régler leurs comptes !
— La Commune, elle est à nous !
— Vive la Commune !
— La Commune éternelle !
Quant aux civils, pour eux la Révolution était faite, et la Commune avait gagné depuis longtemps. Dès mi-avril, ils s'étaient mis à flâner, à s’aimer. Ils s’arrêtaient pour discuter : on n’est plus des bêtes, disaient-ils à qui voulait l'entendre. Leurs élus leur parlaient, de fait, comme à des hommes véritables et leur laissaient le droit de vivre et de penser, d’avoir du temps, d’aller où bon leur semblait, et même de se distraire. Le soir, ils se retrouvaient dans les cafés, assistaient aux concerts et dansaient, chantaient, buvaient jusqu’à l’ivresse. Comme ils étaient heureux !
Comme ils étaient insouciants. Thiers et sa meute de seigneurs, derrière deux cents rangées de fantassins, vinrent bientôt leur dire :
— Votre demande n'est pas celle de mortels.
Les toits flambèrent. On continua de trouer la ville – ponts écroulés, façades arrachées. Les barricades se transformèrent en fosses communes. Les devantures dégueulèrent les entrailles des immeubles. Les derniers Parisiens qui le pouvaient déménagèrent et leurs habitations furent des torches de paille sous un feu que rien ne calma, vorace, rampant le long des rues, transformant la Paris en brasier. La terre des corps en décomposition, le ciel en cendres. Les Versaillais, gagnant le terrain dégagé, répandirent la rumeur : les insurgés eux-mêmes auraient mis le feu à la ville – et ceux-ci furent lâchés par la population civile. Leurs troupes reculèrent jusqu’à la Butte aux Cailles. Pendant ce temps-là les immeubles se contaminaient, communiquaient le feu comme une parole que l’on échange et le dragon les avalait, d’un coup de langue bleue, les uns après les autres. Le 24 mai, il rampait sur les arêtes de l’hôtel de ville. Il le caressa, en explora les contours, paradant sous le ciel nuageux – et puis… Il s’engouffra, dévorant le bois des portes, les poutres, les meubles et les parquets, ne laissant derrière lui qu’un tas de corps pourris, de macchabées la bouche cariée par la cendre. Les pans de murs tombaient et le peuple assistait, impuissant. Le coeur de Paris s’effondrait. Les habitants hurlaient, demandaient à Jésus de pardonner leur faute et la grande bouche de Dieu depuis le ciel cramoisi grondait :
— Quand je vous appelais, vous ne m'avez pas écouté : vous pouvez m'appeler, je ne vous écoute plus.
La Commune était faite.
Brûlée vive, la Commune éternelle ! Delescluze avait dit :
— Maintenant foin des bataillons rangés… Place au peuple, aux combattants aux bras nus !
L’armée n’existait plus – ne restaient que des lambeaux d’escouades composées de socialistes et de fous – et ceux qui n’étaient pas morts avaient fui. Lécréand, lui, n’était pas socialiste. Peut-être était-il fou.
Mais les troupes versaillaises finiraient par passer chez Anne-Marie – elles ratissaient chaque pièce à la recherche de fédérés, inspectaient tout. Si l’on l’y avait trouvé, on les aurait fusillés, tous les deux. Seule elle s'en sortirait.
Il aurait dû mourir depuis longtemps déjà, depuis l'enfer du 4 avril. Il se rendait à ce brasier. Son corps serait comme le pétrole répandu dans la ville : un combustible pour le feu, une croquette pour le dragon qui dévorait Paris. Sa peau, sa chair et ses muscles brûleraient, et il s'évanouirait dans cette fumée qui rejoignait les cieux.
— Adieu.
Anne-Marie restait sur le seuil.
Elle le regardait partir dans le soleil éblouissant, le chassepot en bandoulière. Dans le costume de son mari, il rejoignait la porte Saint-Martin, où se livraient les derniers combats. C'était le 27. Paris libre n'était plus qu'un minuscule carré : Parmentier, le faubourg du Temple, les Trois-Bornes et les Trois-Couronnes, le boulevard de Belleville. Entre ces quatre rues s’élevaient des barricades de rien – des pavés, de la ferraille des chaises et les murs effondrés des maisons que les canons les uns après les autres avaient défoncés et dessous, de la terre, du gravat – à quoi tenait leur territoire ? Leur Commune ! Il n’y avait plus que ça – et pourquoi ? Les Insurgés, sans doute, avaient désiré sans fin. La liberté avec l’égalité, le loisir et l’argent, et la fête – tout ! L’amour ! Et à mesure qu'ils désiraient, leur pauvre Commune se réduisait, comme la peau de chagrin. Les derniers braves se retrouvaient au milieu de cinquante hectares entourés par les flammes, en un combat désespéré de mille contre cent mille.
Je n’étais pas encore monté au front lorsque, parmi trois cents autres combattants (non plus des soldats ou des civils mais rien que des hommes avec la rage, coincés derrière leur barricade comme des rats), je le reconnus, lui, avec sa grande mèche de cheveux bruns et son air élégant, à une vingtaine de mètres de moi, nonchalamment posé contre le mur de la manufacture d'instrument de musiques, dans un renfoncement de la rue Timbaud : c'était Arnaud Blanchard, le soldat du fort d'Ivry. Il fumait là son clope, le regard vide, ce Blanchard même à cause de qui j'avais passé quinze jours derrière les barreaux. Je le fixai de mes yeux noirs – je lui aurais planté ma baïonnette dans le ventre – et il tourna la tête vers moi.
— Hep, toi.
Un mélange de colère et de joie m'envahit. M'avait-il reconnu ? Je m’approchai doucement.
— Oui, camarade ?
Il tapait du pied, sur le sol.
— Je crois bien que je vais mourir aujourd’hui ! dit-il calme, avec une douce mélancolie.
La mort, déjà, avait pris possession de lui ; elle avait recouvert ses yeux d'un léger voile gris qui chaque seconde tournait encore un peu au blanc. Derrière ce minuscule linceul, on eût dit qu'il voyait, non pas les barricades, non pas les combattants aux corps tressés de muscles fins, prêts à se rompre, yeux globuleux barbes hirsutes, qui se relayaient sur le front, mais quelque chose qui n'était pas vraiment du monde, pas ici-et-maintenant. Ou plutôt, même s'il les voyait, car il pouvait les voir, bien sûr, que ce n'était pas lui qui les voyait, mais bien la mort, s'étant installée sous son crâne, qui voyait par ces yeux et comptait froidement, sans même se régaler de cette comptabilité macabre, ses prochains locataires.
— Je vais te montrer quelque chose, dit-il.
Il me prit par la manche : la mort nous avait fait colocataires. Je me laissai guider, comme si c'était la destinée elle-même qui me tirait le bras, pour m'emmener à l’intérieur de la manufacture.
— Ne t’inquiète pas, il n’y a personne.
Il a refermé le grillage. Nous nous sommes retrouvés dans une cour intérieure pavée, bordée de maisons basses, au milieu de laquelle un arbre était planté. Mon esprit fatigué était prêt à tout recevoir ; quelque serpent eût habité dans ce pommier que je l'aurais compris. Nous étions proche du jugement dernier ; les structures mythiques d'un réel essoré de sa graisse se révélaient dans leur pureté. Tout faisait sens.
— Tu entends ?
Blanchard souriait. Un obus éclata. La rumeur des combats reprit…
— Quoi ?
— Approche-toi…
Il me fit lever la tête :
— Il y a des oiseaux, regarde, imbécile ! C'est le printemps, et la vie continue…
Dans le pommier en fleurs, deux moineaux sautillaient, de branche en branche.
Blanchard me fit signe de le suivre. Le bâtiment principal de la manufacture s’élevait sur cinq étages de briques et il fallait monter une douzaine de marches pour parvenir au rez-de-chaussée. Comme l’énorme porte de fonte avait été forcée, il lui suffit de se servir de son fusil comme d’un levier pour l’ouvrir dans un grincement ; j'ai pénétré juste après lui dans une pièce immense, sombre et humide, où résonnaient chacun de nos pas – elle était vide et avait dû être pillée. A l’intérieur, seule l’ouverture grillagée d’un soupirail diffusait la lumière.
Blanchard s’enfonça dans les ténèbres de la pièce.
— Qu'est-ce que tu veux ?
Dans cette pénombre, ma voix, en sortant de ma bouche, s'était dix fois amplifiée. Elle emplissait chaque recoin de l'immense salle vide, comme si ce n'était pas moi, véritablement qui parlait, mais quelque puissance démoniaque venue de moi bien sûr, immatérielle, vivant au fond de moi et qui se fût servie de mes lèvres pour donner une chair à son discours – et me ventriloquait pour résonner encore.
— Tu vas voir.
Et la voix de Blanchard résonnait tout pareillement, et quand elle frappait mes tympans montait et descendait de partout en même temps, m'assaillant à droite et à gauche tant la manufacture, pareille à une église, l'avait amplifiée, déformée, diffractée. Nos frères mouraient, pendant ce temps-là, sur les barricades.
— On a mieux à faire, dis-je en amorçant un demi-tour.
Sa voix comme une camisole vint m’embrasser :
— Lécréand !
Il se souvenait de mon nom, il m'avait reconnu. Alors c'était tout différent. Je me suis retourné.
— Qu'est-ce que tu veux Blanchard ?
Je ne bougeai pas.
— Là où je suis, il y a une trappe, dit-il. Dessous, il y a une cave qui peut accueillir cinquante personnes… Je vais te montrer. Ils ne te trouveront pas.
— On a soudain peur de la mort ? Je croyais que tu t'y préparais, bien bravement...
— Toi tu peux choisir, tu peux t’en sortir. Écoute-moi. Nous allons nous faire écraser, c’est certain.
— Je veux me battre.
— Ne sois pas ridicule. On a déjà perdu.
Je le savais. On avait en effet déjà perdu, et désirer se battre, maintenant, n'avait plus aucun sens. Blanchard se rapprochant traversa la lumière que filtrait le soupirail. L’ombre des grilles se déplaça sur son visage :
— Y a rien à gagner. Ne sois pas stupide. Ta femme t’attend.
— Laisse tomber je te dis.
— Je te comprends, Lécréand. Mais tu te trompes, si tu crois qu'il y a d'un côté des héros, et de l'autre des lâches. Y a que des vivants et des morts.
Je me suis rapproché de lui. Il aurait fallu me faire partir il y a deux mois, au lieu de me jeter dans la geôle. J'allais lui foutre mon poing dans la figure et il la fermerait, une bonne fois pour toutes. Comme ça on serait quitte.
— Tu ne semblais pas si sûr de ton engagement, quand je t'ai rencontré…
Comme une corde trop tendue qui craque, je me ruai vers lui et le plaquai à terre. Je pris sa gorge dans mes pouces – et je serrai, serrai jusqu’à ce qu’il ne puisse plus parler.
— Écoute-moi bien maintenant ! J'ai crié comme un fou. Je m’en souviens plus, de ma femme, t’entends !
Ce n’était pas ma voix, amplifiée par la carcasse vide du bâtiment, qui partait et revenait s'enrouler autour de moi, étrangère la voix d'un autre, située derrière ma voix, venue du soupirail – la voix d’un démon chuchotant derrière mon corps et me domptant, me possédant. Blanchard se défendait à peine sous la pression des pouces au bout desquels je sentais le tambour du pouls s’emballer – mais allais-je tuer cet homme ? Allais-je tuer cet homme ? Effrayé par moi-même je lâchai son cou et saisis sa tête pour la rejeter avec violence, et le punir de m’avoir rendu fou.
Arnaud comme un sac s’effondra sur le sol.
— J’ai vu le visage de mes amis réduits en bouillie ! Les corps coupés par les obus ! L’odeur des morts est rentrée si loin dans mon crâne qu’elle a pourri mon corps, alors je suis déjà mort t’entends !
Il se tenait le cou, gesticulant dans sa douleur.
— Diable ! Lécréand ! articula-t-il d'une voix étouffée.
J'ai couru vers la porte de fonte comme pour me fuir, poursuivi par le bruit des pas. Le soleil m’arracha les yeux. On va finir par se bouffer entre nous ! Pensai-je.
Je me suis assis – ou plutôt j'ai balancé mon corps sur un sac de gravats qui traînait là. Mes jambes tremblaient. Reste tranquille maintenant ! Il n’y en avait plus que pour quelques heures.
Petit à petit, mes yeux se sont habitués au soleil.
Et de cinquante, on est passé à vingt hectares ; l’étau n’en finit pas de se resserrer – on ne mourrait pas l’arme à la main, on crèverait étouffés. Les soldats continuaient de se battre – on entendait les coups de feu et parfois le grondement d’un canon – d’où venaient-ils et quelles tourments avaient-ils traversés, eux qui comme moi se retrouvaient ici au fin fond de l’enfer ? Les mêmes que moi peut-être... Et j’imaginais les batailles, les famines et la boue sur les visages, les pieds déchiquetés, le ventre troué, les épaules meurtries par les sacs…
Blanchard m’apostropha depuis le grillage de la manufacture :
— Lécréand…
Son visage était blême et ses yeux plissaient sous la lumière. Mes pieds continuaient de taper nerveusement le sol. Je n'ai pas répondu. Il se tenait le cou d'une main.
— Longue vie à toi ! cria-t-il.
Il reprit son souffle :
— La mienne, salaud, je l’offre à la révolution.
Et comme si elle lui avait obéi, la détonation lourde et rauque d’un boulet qui sautait par-dessus la barricade, d’effroi me fit tomber de mon sac de gravats – j’étais déjà au sol – les chiens ! – et la terre volait en éclats, retombant sur mon crâne comme une pluie de cendres – le bruit qui trouait les tympans – les yeux cachés au creux des paumes, aveugle et respirant avec difficulté, je n’osais plus me retourner – la fin commençait donc – nous serions morts bientôt, et j’entendis le râle long, la partition où s’élevait le chant des morts – c’était le sifflet de mon tympan percé – replié sur moi-même j’écartai les doigts pour voir à travers leur grillage. Croisant les insurgés, fuyant dans l’autre sens et le visage roussi par la poussière, Blanchard courait l’arme à la main vers la barricade qu’enfonçait déjà l'offensive des troupes de Versailles – il trébuchait sur un pavé, embrochait un soldat, levait son arme comme s’il criait victoire. Un bourdonnement continu s’était installé dans le palais de mon oreille. Versailles ! Ils profitaient de l’effet de surprise pour pénétrer dans le dernier quartier et il remuait son arme éraflant les visages, perçant les corps, manquant de tomber vingt fois et retrouvant l’équilibre comme un pantin dégingandé –
D’une pression insignifiante sur la gâchette un soldat fit planer une seule balle de simple métal.
Blanchard tomba.
Sur la Terre qui tournait imperceptiblement, comme à son habitude.
Tu as de la chance, dit une voix, d’avoir survécu jusque ici ! Il n'y a pas de héros. Déguerpis !
Les soldats n’étaient plus qu’à cinquante mètres et où aller ? Je fonçai vers la première porte ouverte, me prit les pieds dans le palier et en m’aidant des mains m’engouffrai comme un chien, à quatre pattes, à l’intérieur d'une maison, la traversai et ressortis par la fenêtre opposée – la baïonnette se prit dans un rideau – je regroupai mes forces et d’un grand geste le déchirai – l’ouïe revint – une nouvelle rue – j’entendis les voix qui me poursuivaient – des balles trouèrent les murs – je courus comme un dératé tête en avant – zigzaguant sans logique – Paris déserte n’était qu’une ruine grise immense et moi la bête traquée qui n’avais plus de souffle… Je m’arrêtai d’un coup, éclatai une fenêtre avec la crosse de l'arme, escaladai, et m'écrasai au milieu d’une pièce qui puait la mort. Quelques maigres affaires étaient rangées. On n’habitait sans doute plus ici depuis des semaines.
Je rampais sur le plancher défoncé au milieu du verre – quand d’autres voix s'engouffrèrent, avec le vent, par la vitre brisée – je m'accroupis derrière le mur – c'était les soldats de Versailles qui poussaient leurs nouveaux prisonniers – j’avais du verre dans les paumes des mains, sur les genoux. Ils tournaient au coin de la maison et s'arrêtèrent juste derrière la fenêtre éclatée, à un mètre de moi. J’entendais leur haleine, devinais leur coeur battre.
— Es-tu de ceux-là, toi ? demandait-on.
— Nous en sommes, répondit un enfant.
— Quel est ton nom.
— Victor, m’sieur !
— On va te fusiller, attends ton tour.
Le sang dégoulinait, réchauffant mes genoux.
— Vous permettez que j’aille rapporter cette montre à ma mère ?
Les prisonniers durent s'aligner contre le mur, et je sentais déjà les balles plier leurs corps et traverser le mur pour m'embrocher dans la foulée.
Brochette de fédérés.
Alors, malgré le verre et malgré la douleur, sans précaution je m'allongeai par terre et je sentis les bords de chaque bris de la fenêtre, les uns après les autres, crever ma chair en mille endroits comme des boutons de pus.
— Tu veux t’enfuir ?
Je retenais mes larmes et l’enfant répondit :
— C’est juste là, au coin de la rue, et je vais revenir, monsieur le capitaine.
— Va-t’en, drôle !
J'ai prié.
Les balles ont tardé à venir.
J'ai entendu la voix fluette de l'enfant :
— Je suis prêt !
Alors une rafale de balles a balayé le mur – retiens ton souffle – seules deux d’entre elles l'ont traversé – les autres bien logées au fond des coeurs, des estomacs, dans les mètres d’intestin percés – et l’envie de vomir m'a pris lorsque j'ai entendu juste de l'autre côté de la fenêtre le glouglou du sang qui bullait hors de la bouche des fusillés.
— On les laisse là ?
— Qu’est-ce qu’on en fait, lieutenant ?
— On verra plus tard.
J’ai à peine eu le temps de relâcher mon souffle qu’un obus a pété cinquante mètres plus loin ; les soldats se sont mis à courir. J'ai rampé vers la porte située à l’opposé de la fenêtre, me suis levé et ai ouvert la porte – et le soleil, en m'inondant de sa lumière, se réfracta dans les petits bris de verre qui restaient accrochés à mon costume, au milieu du sang qui coulait. Dans la douleur mon corps, mu par une force obscure, s'est remis à marcher, malgré les entailles qui s'ouvraient à chaque pas lorsque les jambes pliaient et dépliaient, et le vent léger qui s’engouffrait à l’intérieur – les portes des maisons se succédaient comme des taches de couleur et les rues perpendiculaires se bousculaient et se croisaient. Je ne sais pas d'où viens cette force. Si c'est ce que l'on appelle l'âme. Ou si c'est l'animal en soi. Ou peut-être était-ce la ville elle-même et les rues, affolées, qui pivotaient autour de moi – non pas moi qui marchais – mais la ville tout entière qui venait s'enrouler autour des jambes – combien de centaines de mètres parcourus, seul, sans rencontrer personne ?
La rue me jette, racontait Lécréand à Allemane, sur l’énorme trouée de Ménilmontant au moment où cinq soldats tirent un prisonnier les mains accrochées dans le dos, gesticulant tellement qu’ils le piquent d’un coup de baïonnette pour le faire avancer. Ils rient – cinq soldats pour ce seul pauvre homme ! Je suis à moins de dix mètres d’eux – je dois relever la tête pour les saluer – il faut que je la relève, je vais relever la tête – je contracte les muscles du cou et mes cheveux tirent mon visage, un rayon de soleil dans les yeux mais – Diable ! Mon regard attrapé par la moustache de… Malcombe me dévisage et – Henri ! – les cinq soldats me dépassent… enfin et je vais respirer… ma tête retombe sur ma nuque… je me suis dominé – Malcombe ! – mais je n’ai pas fait quatre pas que j’entends :
— Vive la Révolution ! Vive la Commune !
Sa voix éclate, brise le ciel comme un vitrail et je vais tomber sur les genoux – je me retourne et les soldats lui tapent sur le haut du crâne d’un coup de crosse pour qu’il la ferme et Malcombe continue :
— Vive la Commune !
Lui aussi s’est retourné car c’est à moi qu’il parle mais les soldats ne l’ont pas compris et ils le rouent de coups et Malcombe en tenant son regard fixé dans le mien s’effondre : un soldat lui a planté sa baïonnette dans le ventre – il tombe à terre et je cours, je cours pour le prendre dans mes bras et on l’achève d’une balle – il se tord sur le sol – du sang va sortir de sa bouche – je suis à genoux aux pieds des cinq soldats.
Ils découvrent ma présence en riant, ils ont compris la scène. Ils rient et mes larmes coulent sur la nuque de Malcombe :
— Henri ! Henri ! Pourquoi n’as-tu pas pris la fuite ?
Le ciel déverse dans mon crâne une tristesse infinie. On agrippe mes aisselles, me relève. Un enfant sans visage empaqueté dans son casque me demande si je connais cet homme – et l’on m’embarque en me poussant d’un coup de baïonnette. Malcombe est resté mort, gisant à terre sur le boulevard comme un chien crevé de Ménilmontant.
Et les combats ont continué sans nous, finissait Lécréand.
— En haut de la rue Oberkampf, répondait Allemane, on se relayait sur le front, caché derrière la barricade, ou tireur isolé, dans les immeubles. On a attendu là, des heures durant, en se contentant de tirer une balle de temps en temps pour affirmer notre présence – jusqu’à ce qu'ils viennent, jusqu'à ce que les combats s’engagent, et que les hommes, des deux côtés, montent risquer leur vie – ça voulait dire la perdre. Bien sûr on savait que les coups de fusils ne suffiraient pas. Mais on n'avait pas le choix : où l'on se battait, où l'on se laissait écraser. Alors, de chaque côté, couverts par les tireurs cachés derrière les murs, les soldats ramassaient toutes leurs forces pour se mettre à courir, escaladant comme ils pouvaient l’accumulation de briques, de tuiles et de tas de sables qu'étaient les barricades, et tombant, se remettant debout, grimpant tout de même à l’affrontement – jusqu’à embrocher leurs ennemis d’un coup de baïonnette. Ils se ruaient sur tout ce qui bougeait, jusqu'à ce qu'un Versaillais leur décoche un pruneau et ils s’affaissaient là, au milieu du néant, avec les autres en train d’agoniser – n’ayant plus pour passer les heures qu’il leur restait à vivre qu’à écouter la symphonie des cris, des larmes et coups de feu qui éclatait partout. On profitait d’une trêve pour les en dégager et on les emmenait dans des hôpitaux de fortune – les chambres des maisons de la rue – à l’intérieur desquels les femmes et les vieux essayaient de les rafistoler. D’autres pièces servaient de cantine ; on s’asseyait, lorsqu’on était en pause, le long de petites tables qu’on avait mises bout à bout et qui faisaient banquet. On mangeait trois fois rien – un peu de pain, de la soupe et des rats, quelques pigeons rôtis – consciencieusement, en sachant que c’était là notre dernier repas ; alors, on s’efforçait d’oublier les obus qui tombaient et dans le drame lorsque tout brûle autour, lorsque l’on ne se bat plus pour vaincre mais parce qu’il n’y a que ça – ou bien s’abandonner à la mort – de la place se faisait à nouveau pour de la joie. Parce qu'on n'en n'avait plus que pour quelques instants et que le futur n’existait plus. Les conventions, les codes, tout s’écroulait autour de nous ; le masque derrière lequel se cachent les hommes craquelait, se fissurait – et j'ai compris soudain l’ivresse de nos quarante-huitards, eux qui couraient depuis vingt ans après leur révolution, la hargne des Polonais comme Dombrowski et Wroblewski qui combattaient pour la Commune à peine revenus des émeutes de Pologne où ils avaient manqué dix fois, cent fois d’y passer – et le sursaut des Algériens ! Ils le connaissaient sans doute tous, ce moment où les hommes affirment... quoi ? On n'a qu'à appeler ça leur liberté ; et ils ne parlent plus, alors, aux autres hommes – c’est face à la mort qu’ils se dressent. Elle éclabousse leurs derniers instants d’une lumière éblouissante. C’est le vertige avant le saut. Vous vous dressez face au néant – vous lui offrez sa part de viande. Ainsi derrière ces barricades retrouvait-on tous les miséreux de la terre et tous les exploités, tous ceux à qui l’on avait dit que leur vie ne valait rien : et ils revêtaient, en luttant, leurs habits glorieux, prouvant non seulement que leur vie en valait bien une autre, valait bien celle des ennemis – mais même plus : qu’elle se cabrait, se rebellait, et résistait – et qu’il faudrait en dépenser, de l’énergie, de la mitraille et de l’intelligence, pour la réduire à rien. Ainsi le 28 mai derrière la barricade tous les damnés du monde luttaient contre cette République qui refermait sur eux son piège. N’était-ce pourtant pas des hommes, de l’autre côté des barricades ? Et des Français, nos frères ? Ils agitaient les torches, les flambeaux et les lançaient dans les immeubles. Leurs yeux pleins de pétrole jouissaient à voir le feu – et ils dansaient, parce qu'eux aussi voulaient leur part de sang. Les énormes canons derrière lesquels ils avançaient ne nous envoyaient des boulets que faute de mieux : ils auraient préféré nous avaler, ou nous broyer. J’étais avec les Justes. Je me battais à leurs côtés. Et ce sentiment seul suffisait à justifier la mort : c'était notre salut. Maintenant que les ans ont passé tout cela me semble moins sûr. Ne sommes-nous pas toujours, en même temps que des opprimés, les exploiteurs de ceux qui souffrent plus que nous ? Exploiteurs, traîtres, salauds – lorsqu’en 78, à Nouméa où l'on nous avait déportés, les Kanak se sont révoltés – qu’est-ce que nous avons fait ? C’était un peuple, comme les Algériens, ils ne demandaient rien qu’à être libres, comme nous l’avions fait en défendant Le Havre contre la Prusse et Paris contre Versailles – un peuple simplement, qui réclame le droit d’être libre... Pourtant on les traitait comme des esclaves, comme des chiens ! L’autonomie – et quoi ? Répondions-nous. Les animaux sont autonomes ? Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Nous qui étions là-bas parce qu’on nous y avait déportés, nous nous sommes rangés dans les bataillons de nos maîtres ! Nous avons obéi à ceux qui nous avaient privés des nôtres – oui nous avons lutté avec les porcs, avec ceux qui, la veille encore, frappaient sur notre propre peau le cuir du martinet, qui nous battaient et qui nous humiliaient : les militaires et les matons. Oui ! C’est avec le pouvoir de Versailles que nous avons écrasé les Kanak ! Alors... Le bon camp ! Les Kanak, on leur avait pris leur île, et on élevait notre bétail sur leurs terres, en leur défendant de cultiver... Alors qu'au fond ils étaient... ben socialistes, socialistes comme les Communards avaient toujours rêvé de l'être... Au bout d'un moment ils ont été à bout et ils se révoltèrent – on jeta dix de leurs chefs en prison. Alors les Kanak se vengèrent en massacrant tous les colons qu’ils rencontraient – y compris les demeures des forçats algériens. Et du coup les Kabyles eux aussi se sont mis dans les rangs pour se venger – et ils se sont offerts à la disposition de l’armée. Du moins ceux qui restaient...
— Parce que les Kabyles eux aussi, reprit Jean Allemane, se sont fait déporter... même si, pour la plupart, ils ne sont pas arrivés jusqu'à destination – le scorbut les a emportés... En vérité, on les a tués petit à petit, parce que sur Le Rhin on n’avait chaque jour qu’un biscuit et un seizième de pain, un bouillon, des haricots et un quart de vin à onze heures ; un biscuit, une soupe de riz, un second seizième de pain à seize – et c’est tout ! Alors on attendait le dimanche, parce que le dimanche une soupe avec du lard nous remplissait le ventre – mais eux, les Kabyles, ne mangeaient pas de porc – et on les affama comme ça. Le scorbut, la gangrène. Ils tombaient dans les pommes les uns après les autres.
— Ils étaient en révolte, les Algériens aussi... Du Tarf à Bou Hadjar, et jusqu'à Bône... Au moment même qu'on se battait, nous autres ! Leur insurrection s'amplifia, jusqu'à ce qu'un dignitaire de l'administration, Mokrani, finisse par les rejoindre ; c'est grâce à lui que les révoltés parvinrent à soulever plus de deux cents tribus, un tiers de l’Algérie ! Un jour que Mokrani, portant un burnous gris pour ne pas être distingué par la blancheur de ses vêtements, ayant gravi je ne sais plus quelle colline, avait mis pied à terre pour faire ses dévotions, sa prière terminée, il resta immobile à quelques pas des siens, inspectant le terrain. Soudain une balle le frappa entre les deux yeux ; il murmura le début d'une profession de foi : « La Illa Illa Allah ; Mohamed Rassoul Allah » et il tomba prosterné, le front touchant le sol. Les siens, m'a dit Kaouane, crurent d’abord qu’il faisait une nouvelle prière ; mais on ne le voyait pas se relever – et il est resté dans cette attitude de prière éternelle, éternelle – il était mort. Alors, partout autour, les hommes se mirent à chanter des chansons, en l'honneur de leur chef :
j’ai regardé par la fenêtre
c’est le bachagha qu’on lavait
on lui enleva les burnous
on lui mit un linceul blanc
on l’enterra à Béni-Abbès
soyez contents ô caïds
soyez contents ô chrétiens
— Bref, reprenait Allemane, les Kabyles eux aussi qui avaient tant souffert se liguèrent avec les gardes pour exterminer les Kanak. Ainsi la colonie emploie-t-elle ses esclaves pour mater ses esclaves ! On a exécuté vingt types à Dumbéa, et les cent trente Kanak vivant à Nouméa, on les a internés au bagne. Ensuite, le premier septembre, assistés par les Algériens et même par une tribu Kanak, on a attaqué Ataï, le chef du clan rebelle, et vous savez quoi ? C’est un Kanak qui l'a tué ! Les esclaves contre les esclaves… La Nation… Elle ne se mouille pas, la Nation ! Les puissants montent les Miséreux les uns contre les autres… Ils nous ont fait couper la tête d’Ataï, et ils l’ont envoyée à Paris en guise de trophée. Et cette fois encore, nous nous croyions du bon côté. Mais je sais maintenant qu'il n’y a pas de mort juste. Pas même les morts de Versailles. Maintenant – car quand je regardais par-dessus la barricade les pauvres types qu’ils envoyaient sur le front, j’avais beau me douter que c’était des pauvres gens comme moi, avec une femme et des enfants, je jouissais à l’idée d’une balle qui sortirait de mon chassepot et percerait leur carotide – oui, je voulais leur sang, c'est tout. On n’apprend rien avec des balles, oh non, sur les barricades – on n’apprend rien ! Les Algériens, et les Kanak – et les Polonais – qui s’étaient révoltés contre le colon Russe ! Tous écrasés également, et les uns par les autres !
— Pourtant, finit Allemane, je ne regrette pas de m'être battu, d'avoir été sur cette barricade de la rue Oberkampf, parce que si l'on n'a pas tout le temps été du bon côté, on était quand même entre braves, à ce moment-là – entre petites gens qui nous battions contre une armée qui pouvait nous broyer et qui nous a broyés. Nous pouvions nous enfuir et nous n'avons pas fui, nous nous sommes battus jusqu'au bout... Mais il faudrait s'arrêter là, Lécréand, je vais m'arrêter là, quand nous étions au sommet de Paris dans notre minuscule carré, dans notre ville libre, et réduite à la taille d'un timbre – on devrait toujours s'arrêter un peu avant, comme s'il n'y avait rien eu après, comme si l'histoire s'était finie, ici, et comme si nous avions gagné. Oui, camarade, dans mon récit on a gagné, et on sera restés du bon côté, éternellement : sur cette barricade où se sont retrouvés, à un moment donné, les révoltés, les exploités ayant enfin sorti leurs armes. C'était très beau. Le reste n'aura pas eu lieu. Pas cette fois.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nos contenus sont sous licence Creative Commons, libres de diffusion, et Copyleft. Toute parution peut donc être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d'origine activée.
date: 17/03/2013 - 18:12
Pierre Vinclair
Qu'y'en a pas un sur cent et qu'pourtant ils existent, Et qu'ils se tiennent bien bras dessus bras dessous, Joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout !
Les Anarchistes !